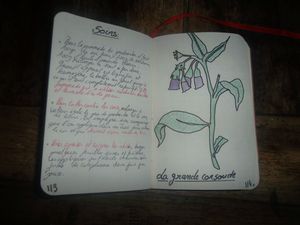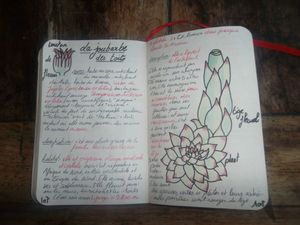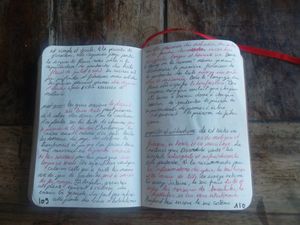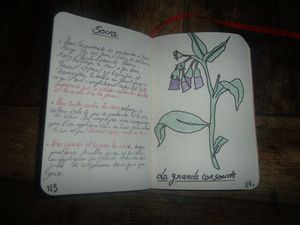Petite sortie dans les prés. Les rosés sont toujours au rendez-vous et bien que dans le premier champs ils n'ont que peu rempli le panier, les coins herbeux alentour ont vite pallié à cet impaire.


Voici un drôle de champignon que je rencontre pour la première fois dans le coin. Il a un odeur qui rappelle celle de l'anis.


Son sa forme juvénille ces lamelles sont d'un blanc légèrement rosé et le haut de son chapeau est légèrement crème. Je doute qu'il s'agisse d'une amanite (absence de 'bulbe"), ou d'une lépiote (absence "d'écailles"). Le mystère reste entier.


Parmis les autres champignons inconnus, ces petites pastilles marrons sur les bogues des châtaignes ou cette moisissure blanche (la moisissure est la forme la plus répandue de champignons) qui prolifère partout, aussi bien sous les arbres des prairies qu'en forêt.


Autres champignons bien sympathiques, ces champignons de bois qui ont poussés sur les troncs de vieux arbres abattus exposés à la pluie et au vent. Du jaune, au orange en passant par le rouge il y en a pour tout les goûts. (à droite un polypore mori).

Les oreilles de judas sont de nouveau là, certes plus petites et moins nombreuses. Il faudra encore attendre un peu avant de les récolter.


Les polypores moris sont bien vieux, on ne les reconnaît presque plus, leur jolie couleur orange ayant disparue. Ne reste plus que leurs étranges alvéoles.


De nombreuses espèces, plus petites, on fait leur apparition aussi.


Les animaux commencent à changer leurs habitudes, le temps des amours est presque finit et de nombreuses petites naissances arrivent. A gauche un chevreuil à marqué son territoire en grattant ses bois contre cet arbre, c'est un moyen de délimiter son harem. A droite une araignée confectionné un cocon dans les têtes de ces millepertuis fanés. Bientôt des centaines de petites araignées en sortirons.


De nombreuses plantes ne fleurissent plus, mais offrent de jolies fruits dont certains sont déjà bons pour la récolte comme les mûres (ainsi que les framboises et les cassis). Les cynorhodons eux attendrons encore un peu, dés que les premières gelées seront passées ils seront prêts.

Pour en savoir plus sur les rosiers sauvages, c'est par là: http://grimoirescarnets.canalblog.com/archives/2012/09/04/25030753.html


La vigne sauvage voit ses feuilles déjà jaunir alors que ces raisins ne sont pas encore murent. Les rares grains violets ont été mangés par les oiseaux qui commencent leurs réservent. Ce raisin sauvage n'est pas très bon à consommer, il est acide et donne des aigreurs d'estomac, il est bien meilleur transformé en confiture ou en boisson rafraîchissante comme en jus, sirop ou limonade.


L'ail sauvage a fini par fané, les graines seront bientôt bonnes a être cueillies pour la cuisine (à gauche).Les crocus ont fait leur apparition en grand nombre cette année et plus tôt qu'à l'accoutumée.

Les lianes voient leurs fruits chatoyant devenir rouges, en passant par toute une gamme de couleur. Prudence, bien qu'ils soient attirant, ils n'en restent pas moins toxiques.


Les matins se font plus frais et la brume se fait plus présente. D'ici quelques mois, les vaches reprendront la direction des stabules et des étables.


Les vesses de loup on envahit les prés et les forêts. C'est un champignon amusant, quand il est à maturité il libère ses spores en se perçant. Une seule pression sur un d'eux avec un bâton permet de voir tout un nuage vert-gris s'en dégager. La vesse de loup n'est pas un très bon comestible, pour la cuisine il faut choisir des préférence les specimens jeunes et fermes.



Les princes et princesses fourmis prennent leur envole. Ils iront à leur tour former une nouvelle colonie, à moins de finir dans l'estomac d'un oiseau ou d'un crapaud qui en sont friands.


Tout comme les noisettes, les noix commencent à tomber. Il faudrat attendre encore un peu avant de les consommer car dégustées après qu'elles soient tombées de l'arbre, elles sont trop fraîches et provoquent des aphtes. Pour cela, on les dispose sur de grands séchoirs.


Les gerbes d'or sont presque toutes fanées, les fleurs se mues en graines (à gauche). Quand aux vinaigriers, ma foi il se portent bien et abordent des cônes pourpres qui entre dans la composition de nombreuses limonades.

Les marasmius rotula sont de jolis petits champignons au pied noir et au chapeau blanc. Ils poussent sur les feuilles mortes des feuillus.
Bref, les prairies et les prés eux aussi regorgent de vie et de petits trésors.



/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F6%2F865811.jpg)